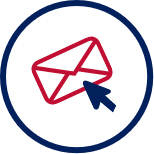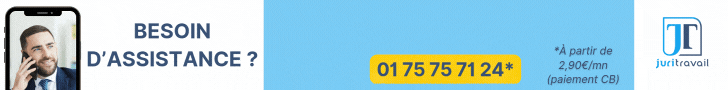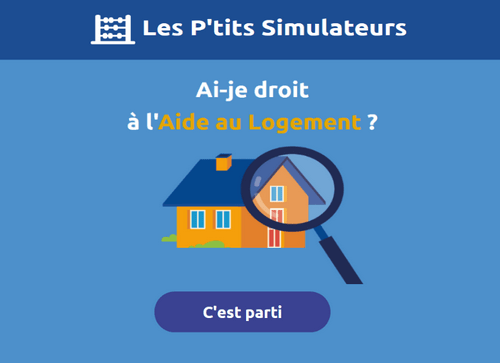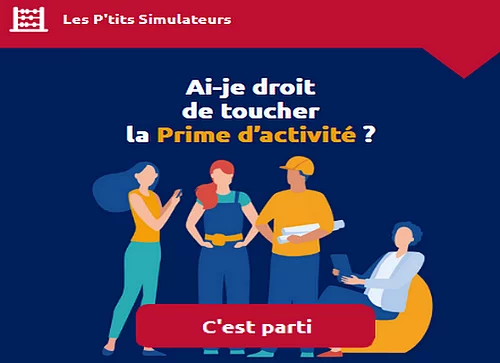SOMMAIRE
Le salaire : une obligation contractuelle essentielle
Le contrat de travail impose des obligations à la fois au salarié et à l’employeur. La principale ? Le salarié travaille pour son employeur selon des horaires établis. Et en échange, l’employeur le rémunère. Cette base est cruciale dans le Code du travail et c’est sur cette dernière que vous pourrez, potentiellement vous appuyer, pour refuser de reprendre votre poste si vous n’avez pas reçu votre salaire. On parle d’inexécution contractuelle légale.
La différence entre suspension et non-paiement de salaire
Pour ne pas être mis en défaut par votre employeur, ou pire par le Conseil de prud’hommes si l’affaire venait à s’envenimer au point de devoir saisir un juge, il est important de bien faire la distinction entre suspension et non-paiement de salaire.
Absences et rémunération :
- Grève : les heures non travaillées ne sont pas rémunérées ; ce n’est pas un non-paiement fautif.
- Arrêt maladie : le salaire contractuel peut être suspendu, mais vous percevez des indemnités journalières de la Sécurité sociale et, selon la loi et/ou la convention collective, un complément employeur.
- Congé maternité/paternité : le salaire est remplacé par des indemnités de l’Assurance maladie ; un maintien partiel ou total peut s’ajouter si prévu par la convention.
- Inaptitude : à l’issue d’un mois après l’examen de reprise, en l’absence de reclassement ou de licenciement, l’employeur doit reprendre le paiement du salaire (Code du travail, art. L1226-4).
Ces cas ne constituent donc pas un « non-paiement de salaire » fautif.
Le non-paiement de salaire est différent : vous avez fait votre quota d’heures, il est donc tout à fait logique d’être rémunéré pour cela… mais rien ne s’affiche sur votre relevé de compte bancaire. Cela peut ne concerner qu’un seul mois, mais pas forcément ! Dans la très grande majorité des cas, ce n’est pas de la mauvaise foi, mais plutôt que l’employeur traverse des difficultés financières ponctuelles. Cependant, et il est important d’appuyer sur ce fait, aux yeux des juges, cette raison ne justifie en aucun cas de ne pas vous verser votre salaire !
Bon à savoir : un paiement partiel de votre rémunération (par exemple : un simple acompte ou l’oubli d’une prime ou d’heures supplémentaires) est considéré comme un non-paiement de salaire.
Le bulletin de paie n’établit pas le paiement du salaire : seul un justificatif comptable ou bancaire de l’employeur le prouve. Sa remise (même signée) n’emporte pas renonciation : vous pouvez toujours réclamer les sommes impayées.
Les délais légaux de paiement du salaire
Avant d’aller plus loin concernant l’exception d’inexécution en cas de non-paiement de salaire, il est important également de bien comprendre que les règles sont différentes pour un simple retard de versement. Par extension, il nous semblait donc logique de faire un point rapide sur le délai légal pour recevoir votre paie.
L’article L3242-1 du Code du travail prévoit une rémunération mensuelle. Par exemple, si vous êtes payé le 28 du mois, vous devrez continuer à avoir votre salaire à cette période (hors week-ends et jours fériés).
Précisions utiles :
- Nouvelle embauche : il n’existe pas d’« exception légale » pour dépasser librement un mois. La date de paie est fixée par l’usage/contrat et doit être respectée.
- Rupture du contrat (solde de tout compte) : les sommes dues à la rupture sont payées à la date de fin de contrat (remise du solde de tout compte).
L’exception d’inexécution : refuser de travailler en cas de non paiement du salaire
Puis-je arrêter de travailler si je ne suis pas payé ? La réponse est oui… sous certaines conditions !
L’exception d’inexécution
Nous l’avons vu dans la partie précédente, si votre employeur ne vous rémunère pas dans les délais imposés, il se rend coupable d’un manquement grave pouvant justifier l’exception d’inexécution : le salarié peut suspendre sa prestation si le manquement est suffisamment grave et qu’il notifie rapidement son employeur (art. 1219 et 1220 du Code civil).
Le hic ? La loi ne prévoit pas un cadre spécifique à ce cas de figure, contrairement au droit de grève ou au droit de retrait (en cas de danger grave et imminent pour la santé et/ou la sécurité des salariés). Heureusement, la jurisprudence et les nombreux cas concrets qui sont passés devant les tribunaux permettent d’établir des conditions à respecter pour que cette inexécution contractuelle soit légitime et donc que le refus de travailler du salarié le soit aussi par extension.
Les conditions à respecter pour que le refus de travailler soit légitime
Pour que votre refus de travailler soit légitime au titre de l’exception d’inexécution :
- Le manquement de l’employeur au paiement du salaire dû doit être suffisamment grave (appréciation par le juge).
- Adressez une notification écrite (idéalement une mise en demeure) indiquant le salaire impayé et votre décision de suspendre la prestation jusqu’à régularisation.
- Restez disponible pour reprendre immédiatement une fois le paiement effectué.
- Conservez toutes les preuves (relevés, échanges).
Remarque : plusieurs mois d’impayés ou des montants élevés renforcent la gravité, mais ce ne sont pas des conditions légales automatiques. Tout dépend des circonstances.
Dans le cas contraire, le refus de travailler peut être jugé abusif. Depuis 2023, l’abandon de poste peut entraîner une présomption de démission si, après une mise en demeure écrite de reprendre le travail laissant un délai minimum de 15 jours, vous ne revenez pas à votre poste ni ne justifiez votre absence. Cette présomption peut priver de l’allocation chômage. Pour limiter le risque, notifiez par écrit votre position (exception d’inexécution) et restez disponible pour reprendre dès régularisation.
Je n’ai pas reçu mon salaire, que faire : les recours
Si refuser de travailler pour non-paiement de salaire est une solution. Cela ne reste qu’une solution ponctuelle. Vient alors la question « Quels sont mes droits si je ne suis pas payé ? » Il existe plusieurs recours pour les faire valoir tout en étant protégé juridiquement parlant. Explications.
Un règlement à l’amiable avec son employeur
Dans un premier temps, le plus simple est de vous rapprocher de votre employeur pour lui faire part du retard prolongé de votre salaire. Vous pouvez ainsi contacter les ressources humaines, le service comptabilité, voire le service paie dans certaines grosses structures ou même solliciter un entretien avec votre patron pour les petites entreprises.
L’idée est de demander des explications sur cet incident (= retard administratif, problème financier par exemple) et de pouvoir faire régulariser rapidement la situation.
Bon à savoir : nous vous recommandons de garder des traces écrites de ces échanges (emails, comptes-rendus d’entretien, etc.). Cela vous sera utile si vous devez saisir le Conseil de prud’hommes.
La mise en demeure de son employeur
Si malgré les échanges aucune solution n’a été trouvée et que vous n’avez toujours pas été payé, vous pouvez envoyer une lettre de mise en demeure de payer à votre employeur.
Sur cette dernière, indiquez précisément :
- le montant exact des salaires dus ;
- les périodes de travail concernées ;
- le délai de régularisation (vous pouvez opter pour une formulation de type : « À défaut de régularisation sous 8/15 jours, je me verrai contraint[e] d’engager des actions légales. »).
Bon à savoir : pensez à faire une copie de ladite lettre et à transmettre ce courrier en recommandé avec accusé de réception pour conserver une trace.
Voici un modèle de lettre de mise en demeure :
L’aide des syndicats et de l’Inspection du travail
Pour appuyer vos démarches, vous pouvez vous faire accompagner par les syndicats. Ces derniers peuvent également vous prodiguer des conseils juridiques et vous assister en tant que défense devant les prud’hommes.
Du côté de l’Inspection du travail, l’organisme peut être contacté pour constater le non-respect des obligations de l’employeur. Cela vous rassurera et apportera une preuve conséquente au juge. Malheureusement, son pouvoir ne va pas plus loin : elle ne peut pas exiger le versement des salaires manquants.
La saisine du Conseil de prud’hommes
C’est l’ultime recours en cas de non-paiement de salaire. Vous pouvez saisir le Conseil de prud’hommes pour réclamer les sommes dues et obtenir des dommages et intérêts pour compenser le préjudice. Cette procédure est bien évidemment gratuite et peut même être engagée en référé (c’est-à-dire en urgence) si les montants sont importants.
Bon à savoir : il est possible d’être assisté par un avocat, mais cela n’est pas obligatoire. Vous pouvez également demander à être accompagné par un syndicat si vous ne souhaitez pas être seul.
Enfin, prenez garde : la prescription des salaires est de 3 ans à partir de la date de paiement du premier salaire manquant. Cela signifie qu’il ne faut pas attendre trop longtemps au risque de se voir « retoqué » par les juges !
La rupture du contrat aux torts de l’employeur
Si vous avez le droit de refuser de travailler pour non-paiement de salaire, sachez qu’il est aussi tout à fait possible de rompre votre contrat de travail pour la même raison.
Deux cas de figure sont envisageables :
- La prise d’acte : vous envoyez une lettre indiquant que le contrat de travail est rompu du fait des manquements graves de l’employeur. Puis, vous saisissez le Conseil de prud’hommes pour faire requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce faisant, vous pourrez bénéficier de l’allocation chômage (sous couvert de respecter les autres critères d’éligibilité). Attention ! La prise d’acte est risquée, car si les prud’hommes refusent l’inexécution contractuelle légale, la rupture de votre contrat de travail sera requalifiée en démission… et les conséquences qui vont avec ! En outre, durant le laps de temps qui s’écoule entre votre départ de l’entreprise et le jugement de l’affaire, vous n’êtes pas payé.
- La résiliation judiciaire : la saisine des prud’hommes se fait alors que vous êtes toujours en poste. Ce sont les juges qui acteront l’inexécution contractuelle légale, obligeront votre employeur à verser ce qui vous est dû et prononceront la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier. C’est une solution moins risquée que la prise d’acte puisque vous conservez votre poste (et votre salaire — même si celui-ci ne vous est pas versé par l’employeur, il le sera après le jugement) durant la procédure.
Non-paiement de salaire et refus de travailler : un cas de jurisprudence
Le salarié se plaint du non-paiement de sa rémunération. En réaction, il a arrêté de travailler. Son employeur l’a licencié pour abandon de poste. La loi valide cependant l’inexécution contractuelle de l’employeur et lui impose le versement des montants dus ainsi que de dommages et intérêts.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-10.697
Dans ce cas de jurisprudence, le juge a pu vérifier concrètement la réalité du manquement de l’employeur, son caractère fautif et sa gravité. Il s’est ensuite appuyé sur le principe fondamental du versement du salaire comme obligation essentielle de l’employeur pour réfuter l’abandon de poste et le requalifier en inexécution contractuelle.
Salaire impayé : la FAQ
Dans cette foire aux questions, nous rassemblons les interrogations les plus courantes et des réponses synthétiques, pratiques et à jour, pour vous aider à comprendre vos droits et choisir la démarche adaptée à votre situation.
Puis-je me présenter sur site mais refuser d’exécuter la prestation tant que le salaire n’est pas régularisé ?
Oui, au titre de l’exception d’inexécution (suspension de votre prestation). Faites-le avec prudence : notifiez par écrit que vous vous présentez mais suspendez l’exécution tant que le salaire dû n’est pas payé, restez disponible pour reprendre dès régularisation et conservez toutes les preuves (relevés, pointages, échanges).
Pendant l’exception d’inexécution, dois-je rester joignable et disponible ?
Oui. Restez joignable aux horaires habituels (téléphone, e-mail), indiquez un moyen de contact ou un passage sur site (badgeage) sans exécuter la tâche, et précisez par écrit que vous reprendrez immédiatement dès paiement. Cette disponibilité réduit le risque de présomption de démission après mise en demeure de reprendre.
L’employeur peut-il me sanctionner disciplinairement si je suspends mon travail ?
Il peut tenter de le faire, mais la sanction sera annulée si votre suspension est légitime (impayés avérés, gravité, notification loyale et proportionnée). D’où l’importance d’une mise en demeure claire et datée. À l’inverse, une suspension hâtive ou sur dette contestable peut exposer à une sanction valable.
L’employeur peut-il refuser un acompte que je lui réclame si le salaire n’est pas versé ?
Selon l’article L3242-1 du Code du travail, tout salarié payé au mois peut demander, à partir du 15 du mois, un acompte sur salaire correspondant à une quinzaine de travail (soit environ 50 % du salaire mensuel). L’employeur doit accepter le premier acompte demandé dans le mois (pour du travail déjà effectué).
Le délai de prescription pour réclamer des salaires impayés est-il limité ?
Oui, vous pouvez intenter une action en justice dans un délai de 3 ans à compter du jour où le premier salaire aurait dû être versé.
Retards récurrents mais salaires finalement payés : puis-je obtenir des dommages-intérêts ?
Oui, si vous prouvez un préjudice (frais bancaires, agios, loyers en retard, préjudice moral documenté, etc.). La répétition de retards peut aussi justifier une résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, selon le contexte.
Absence de bulletin ou dissimulation d’heures : quand parle-t-on de travail dissimulé ?
Il y a travail dissimulé en cas de dissimulation d’emploi salarié (absence volontaire de déclaration/bulletins) ou de dissimulation d’activité/heures (minoration intentionnelle). Les conséquences sont lourdes (indemnité forfaitaire, pénal). Si vous suspectez une dissimulation, documentez les faits et saisissez l’Inspection du travail et/ou les prud’hommes.
D’autres articles peuvent vous intéresser :
Crédit photo : © amnaj / Adobe

Depuis 2019, je dédie ma plume aux aides sociales et aux démarches administratives. Mon objectif : vous offrir un maximum d’informations, tout en vulgarisant ce que j’aime appeler « le langage Caf ». Pour que chacun puisse bénéficier des prestations auxquelles il a droit !