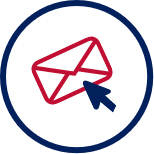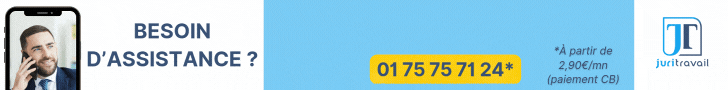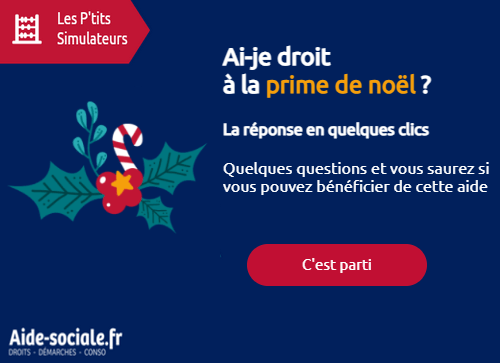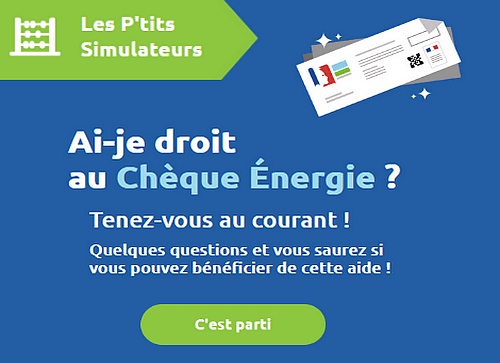SOMMAIRE

Comment le juge évalue l’attribution ou le refus de prestation compensatoire ?
Le juge aux affaires familiales a besoin de critères factuels et objectifs pour décider si une prestation compensatoire est nécessaire pour assurer un équilibre entre les anciens conjoints après le divorce.
Ces critères sont fixés par l’article 271 du Code civil et sont au nombre de 7 :
- la durée du mariage ;
- l’âge et l’état de santé des époux ;
- les qualifications et situations professionnelles des conjoints ;
- les décisions professionnelles prises durant le mariage pour l’éducation des enfants ou pour soutenir la carrière de l’autre (et par extension, leurs conséquences) ;
- le patrimoine estimé ou anticipé des conjoints ;
- les droits actuels et futurs ;
- les pensions de retraite anticipées.
Vous l’aurez compris, lorsqu’un juge refuse une prestation compensatoire, c’est qu’un (ou plusieurs) de ces critères fait défaut.
Les motifs de refus de prestation compensatoire les plus courants
Dans la jurisprudence, certains motifs de refus de prestation compensatoire sont plus fréquents que d’autres. Faisons un tour d’horizon du sujet.
1-L’absence de disparité significative dans le niveau de vie
Pour rappel, la prestation compensatoire a, comme son nom l’indique, pour but de compenser un déséquilibre financier entre les anciens époux après leur divorce. Il arrive néanmoins que dans certains cas, le juge aux affaires familiales considère que les deux ex-conjoints ont un niveau de vie équivalent après leur séparation ou qu’une des personnes a des compétences et des qualifications professionnelles suffisantes pour maintenir son niveau de vie.
C’est le cas par exemple si chacun a un revenu suffisant et stable, un logement et est autonome financièrement. Le juge peut estimer que la prestation compensatoire n’a pas à être versée, et ce, même si le niveau de vie n’est pas le même qu’avant divorce. Eh oui ! le dispositif vise uniquement à compenser une disparité, il n’est pas là pour assurer le confort ou un train de vie identique.
2-La durée très courte du mariage
Le juge aux affaires familiales peut refuser une prestation compensatoire si votre mariage a été de courte durée. Et pour cause, le magistrat considère souvent que vous et votre ancien conjoint n’avez pas passé suffisamment de temps ensemble pour qu’un écart économique important apparaisse.
Généralement, il est plutôt simple de retrouver son niveau de vie d’avant le mariage si ce dernier n’a duré que quelques mois ou années. Une aide financière n’est donc pas indispensable.
3-Le divorce prononcé aux torts exclusifs du demandeur
En cas de divorce pour faute, et selon l’article 270 du Code civil, le conjoint fautif peut se voir refuser la prestation compensatoire. C’est le cas par exemple lorsqu’il y a violences conjugales ou adultère (= infidélité). Seule exception : si la situation financière dudit conjoint est très déséquilibrée !
Bon à savoir : le comportement des époux durant leur mariage a un impact. Chacun a des droits, mais aussi des obligations. Et le manquement à ces dernières peut avoir des répercussions pendant et après la séparation.
4-Des capacités et opportunités de travail non exploitées
Si le juge aux affaires familiales estime que le conjoint peut, au vu de ses compétences et qualifications professionnelles, trouver un emploi lui permettant de rectifier son niveau de vie, c’est un motif de refus de prestation compensatoire. Il en va de même si celui-ci a volontairement réduit ou arrêté son activité professionnelle afin de profiter d’une prestation compensatoire.
C’est une situation très fréquente dans les tribunaux.
5-Revenus suffisants du demandeur
Rappelons à toutes fins utiles que la prestation compensatoire n’est pas là pour égaliser les revenus des anciens conjoints, mais pour compenser un déséquilibre.
Ainsi, même s’il y a une disparité entre la situation économique de chacun après le divorce, si le demandeur a un train de vie déjà confortable qui n’est pas aussi élevé que pendant le mariage, le juge aux affaires familiales a tout à fait le droit de refuser la prestation compensatoire.
6-Refus motivé par un comportement dilatoire ou abusif
Que ce soit pour ralentir la procédure de divorce ou pour nuire volontairement à l’ancien conjoint, certaines personnes n’hésitent pas à faire une demande de prestation compensatoire !
Or, si une demande est faite tardivement, sans justificatif, au cours d’une procédure de divorce déjà bien entamée, le juge peut estimer que ladite demande n’est animée que par une volonté de faire pression, de léser ou de blesser l’autre personne. Dans ce cas, le refus est systématique.
7-Disparité créée artificiellement (arrêt volontaire du travail, dissimulation de ressources)
Certaines personnes espèrent créer une disparité de niveau de vie en modifiant artificiellement leur situation avant ou pendant le divorce : arrêt volontaire du travail (= démission) juste avant le divorce, diminution conséquente du nombre d’heures de travail, dissimulation de ressources (livret A et autres actifs).
Comme dans le cas précédent, le juge aux affaires familiales va s’apercevoir que l’inégalité est provoquée volontairement (pour nuire à l’ancien conjoint par exemple) et pourra rejeter la demande de prestation compensatoire.
8-Absence de justificatifs suffisants
La demande de prestation compensatoire se fait par le biais d’un dossier. Et celle-ci doit être argumentée et cela passe par l’ajout de documents comme des bulletins de salaire, des relevés bancaires, des attestations, etc.
Si le JAF estime que les éléments fournis ne permettent pas de justifier une disparité de ressources, c’est un motif de refus de prestation compensatoire.
Jurisprudence refus de versement de prestation compensatoire : 2 exemples concrets
Nous en avons terminé avec la théorie, place à la pratique avec ces deux cas concrets de jurisprudence.
Exemple 1 : après 17 ans de mariage sous séparation de biens, sans patrimoine commun ni enfant, l’ancienne épouse demande une prestation compensatoire qui lui est refusée.
Cour de cassation, 1ʳᵉ civ., 1er février 2017, n° 16 — 13 504
La Cour a refusé l’attribution d’une prestation compensatoire en s’appuyant notamment sur le fait que la disparité de niveau de vie n’était pas due au divorce, mais existait avant celui-ci (puisque les deux époux s’étaient mariés sous le régime de la séparation de biens). Le motif de refus de prestation compensatoire est donc fondé sur l’absence de disparité née du mariage.
Exemple 2 : le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l’ancienne épouse. Malgré leurs 3 enfants, la demande de prestation compensatoire lui a été refusée.
Cour de cassation, 1ʳᵉ civ., 30 avril 2014, n° 13 — 16 649
Avec ce cas de divorce pour faute (infidélité, abandon de charges), la Cour a estimé que le juge pouvait refuser la prestation compensatoire en raison des circonstances particulières de la rupture, malgré la disparité flagrante de niveau de vie post-divorce.
Remarque : nous avons volontairement simplifié le jargon juridique. Les deux situations présentées sont bien plus complexes en réalité, mais la décision est bel et bien celle indiquée par nos soins.
Comment contester un refus de prestation compensatoire ?
Vous souhaitez faire un recours contre un refus de prestation compensatoire ? C’est très simple : vous avez un délai de 1 mois à partir de la notification du jugement pour faire appel à la décision du juge aux affaires familiales.
Pour ce faire, nous vous recommandons très fortement de vous faire accompagner par un avocat spécialisé en droit de la famille qui sera capable d’argumenter sur la disparité des ressources et démontrer que votre demande initiale de prestation compensatoire était tout à fait justifiée.
N’oubliez pas non plus que la Cour d’appel va réexaminer votre dossier. Il est donc impératif que celui-ci soit plus solide que lors de sa parution devant le JAF. En outre, la procédure est technique et suppose de réévaluer la situation économique des deux anciens époux.
Bon à savoir : en cas de difficulté financière, vous pouvez faire une demande d’aide juridictionnelle.
FAQ – Refus de prestation compensatoire
Qu’est-ce qu’une prestation compensatoire ?
La prestation compensatoire est une somme d’argent ou un autre avantage accordé à l’un des ex-conjoints lors d’un divorce afin de compenser un déséquilibre important dans les conditions de vie. Son objectif n’est pas d’égaliser les revenus, mais d’assurer un équilibre raisonnable en tenant compte des sacrifices professionnels ou personnels faits pendant le mariage. Elle est décidée par le juge aux affaires familiales selon des critères précis définis par la loi.
Est-il possible de négocier une prestation compensatoire à l’amiable ?
Oui. Avant de laisser le juge trancher, les ex-conjoints peuvent convenir ensemble d’un montant ou d’une modalité de versement, à condition que l’accord soit équilibré et homologué par le juge. Cette approche permet d’éviter un refus judiciaire, tout en préservant un climat plus serein et en réduisant les frais liés à une procédure contentieuse. Une discussion encadrée par des avocats ou un médiateur familial est souvent recommandée pour sécuriser l’accord.
Le montant de la prestation compensatoire peut-il être modifié après décision ?
Oui, mais uniquement dans des cas spécifiques. Une prestation compensatoire versée sous forme de capital ne peut généralement pas être modifiée. En revanche, lorsqu’elle est versée sous forme de rente, elle peut être révisée, suspendue ou supprimée si la situation financière de l’un des ex-conjoints évolue considérablement. Cette révision nécessite une décision judiciaire et des justificatifs solides.
Les décisions de refus sont-elles toujours définitives ?
Pas forcément. Un refus initial peut être contesté par un appel ou une demande de révision en cas d’éléments nouveaux. Cependant, ces recours doivent être bien argumentés et soutenus par des preuves concrètes. Un simple désaccord avec la décision du juge ne suffit pas pour obtenir une révision.
📚 D’autres articles peuvent vous intéresser :
Crédit photo : © Anim / Adobe

Depuis 2019, je dédie ma plume aux aides sociales et aux démarches administratives. Mon objectif : vous offrir un maximum d’informations, tout en vulgarisant ce que j’aime appeler « le langage Caf ». Pour que chacun puisse bénéficier des prestations auxquelles il a droit !